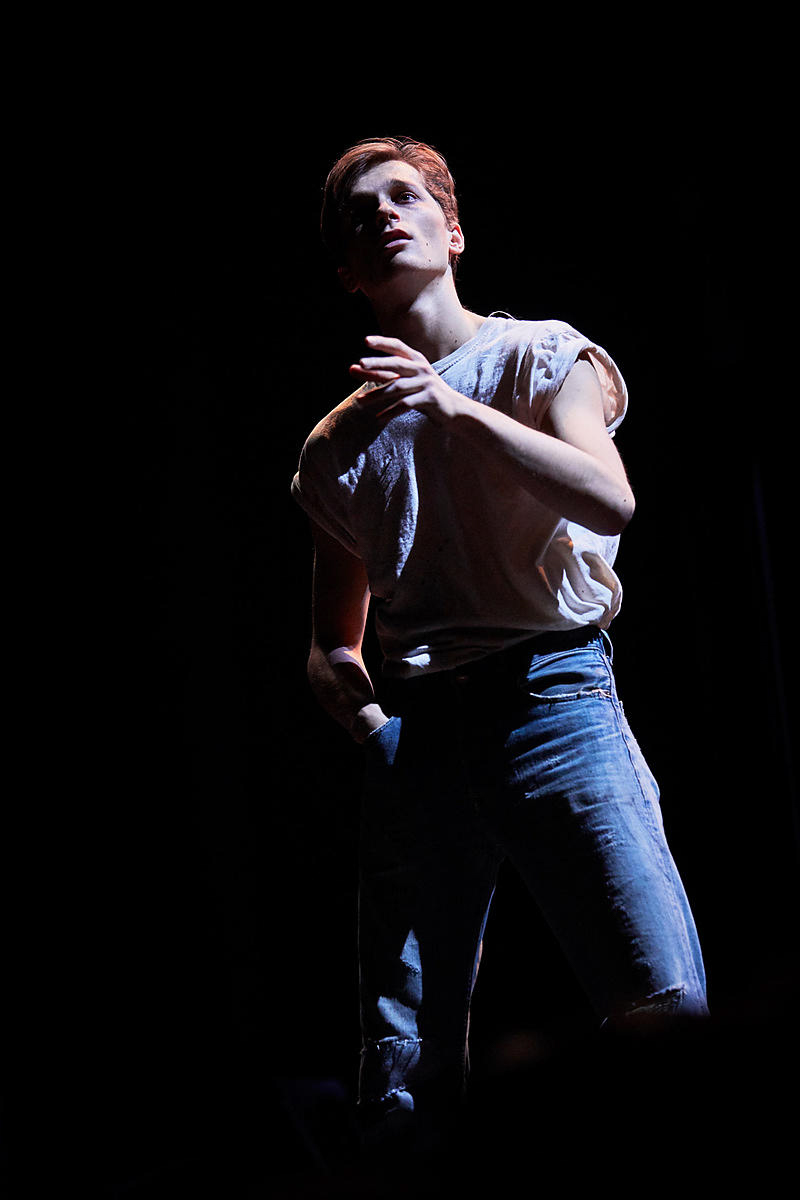MISES EN SCÈNE

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
XAVIER GALLAIS
ADAPTATION ET DRAMATURGIE
FLORIENT AZOULAY
SCÈNOGRAPHIE – PROJET
LUCA ANTONUCCI
AVEC
MOHAMED BELHADJINE
ALINE BELIBI
MAËL BESNARD
TEDDY CHAWA
MANON CLAVEL
MÉGANE FERRAT
BENJAMIN GAZZERI GUILLET
LEAH LAPIOWER
JEAN-BAPTISTE LE VAILLANT
LOUISE LEGENDRE
ALEXANDRE MANBON
NADINE MORET
ANTHONY MOUDIR
D’après W. Faulkner le passé n’est jamais mort, il n’est même pas passé. On porte en soi une histoire qu’on ne peut pas nier et dont on ne parvient pas à se libérer.Ainsi, le sang des personnages faulknériens est inexorablement contaminé par les crimes irréparables et les défaites honteuses de leurs ancêtres. L’auteur les aban-donne sur une terre déjà maudite. Le comté imaginaire du Yobnapatawpha saccage l’illusion du mythe du Nouveau Monde : depuis longtemps, il n’y a plus de territoire vierge à découvrir. Plus de nature originelle et inviolée. Le paysage, même intérieur, a déjà été visité, souillé de partout, dans tous les sens. Tragiques, les personnages sont condamnés à endurer une réalité mouvante qui leur échappe bien souvent; condamnés à errer dans une temporalité disloquée à travers les labyrinthes de leur mémoire fragmentée. Il ne reste guère à ces êtres-là que les mots pour tenter de se réparer, peut-être retrouver la trace perdue d’une source pure? Mais la parole elle-même omet, remplace, dissimule car elle est poésie pure. Cauchemar absolu dont le rituel théâtral donne enfin à entendre les souffles affolés des spectres qui ont hanté l’imaginaire de bien des lecteurs exigeants.
XAVIER GALLAIS

L’ENFER DE L’HISTOIRE RECOMMENCÉE
Il est difficile pour nous de mesurer le traumatisme historique que représente aux États-Unis la guerre de Sécession, the Civil War. Ce conflit, qui a provoqué entre 1861 et 1865 la mort de près d’un million de personnes – sans compter les 500 000 mutilés et invalides –, demeure une des pages les plus tragiques de l’histoire américaine. Les 13 états confédérés, gouvernés par une petite aristocratie de gentlemen farmers qui régnaient sur plusieurs millions d’esclaves noirs, ont perdu près de 50% de leurs hommes, leurs hommes blancs, plongeant dans une longue période de ressentiment, où la rédemption morale était impossible, la reconstruction empêchée par l’arrogance des vainqueurs du Nord.
Les Sudistes vont dès lors ressasser jusqu’à l’obsession le temps heureux de l’avant-guerre et celui illustre des batailles, ancrant ainsi une large part de leur imaginaire dans une mythologie aussi outrancièrement idéalisée que sanglante. Dans les esprits des vaincus et de leurs descendants s’imposeront, à la place des ruines et des plantations dévastées, les visions idylliques de somptueuses demeures néo-palladiennes où de belles femmes en grande robe à crinoline, entourées d’élégants galants et de fidèles grosses nourrices noires, regardent depuis l’ombre douce des vérandas, nonchalamment alanguies sur des fauteuils en rotin, les esclaves travailler en chantant dans les champs de coton. Mais à ces tableaux kitsch, qui empestent le magnolia, des photos en noir et blanc vont bientôt succéder, images nauséabondes qui sentent la chair brûlée, la sinistre odeur des étranges fruits de Billie Holliday qui pendent aux arbres, l’odeur des lynchages, l’odeur de bois brûlé des grandes croix enflammées la nuit. Qui n’a à l’esprit, quand on évoque le sud des États-Unis, ces inquiétantes processions de fantômes armés, portant de longues robes blanches, et coiffés de capirotes qui masquent les visages ?
Si les monuments érigés à la gloire des héros confédérés dans les villes et les campus d’universités suscitent désormais de violentes polémiques, ils témoignent de la persévérance du mythe de la cause perdue, mythe rebelle. Les généraux en bronze, interrogeant l’histoire contemporaine de leur présence embarrassante, fiers et superbes sur leur cheval, regardent silencieusement un monde – car le sud des États-Unis fait monde – où règne toujours l’injustice raciale, triste héritage de l’esclavage et de la ségrégation. À Charlottesville, il y a un peu plus d’un an, lors d’un rassemblement d’extrême-droite visant à empêcher le déboulonnage de la statue du général Robert E. Lee, un jeune suprémaciste blanc a foncé en voiture sur des contre-manifestants antiracistes, tuant une personne et en blessant une vingtaine. Un siècle et demi après, la rancœur demeure. Les États-Unis n’ont cessé de faire croire à l’union, mais aujourd’hui encore – et Donald Trump en est l’ubuesque symbole –, ce pays reste profondément divisé. Les frontières existent bel et bien, dans les terres, dans les consciences.
Plus que dans la folie – ou plutôt la bêtise – meurtrière de quelques extrémistes isolés, c’est dans sa littérature que le sud des États-Unis mérite qu’on s’intéresse à l’expression troublante et brutale de son ressentiment. Une longue série d’écrivains de premier ordre, Flannery O’Connor, Eudora Welty, Carson McCullers, Margaret Mitchell – beaucoup de femmes nourriront de leur récits l’imaginaire sudiste –, Erskine Caldwell ou Robert Penn Warren, va entreprendre de raconter les affres des habitants de ce territoire maudit. Le plus puissant de tous reste, sans conteste, William Faulkner, prix Nobel de littérature en 1949, qui laisse à la littérature des chefs-d’œuvre de noirceur tels que Le Bruit et la fureur, Tandis que j’agonise, Lumière d’août ou Absalon, Absalon !
Vivant dans la petite ville d’Oxford dans le Mississippi, Faulkner, dont le grand-père a servi comme colonel dans l’armée confédérée, partage les obsessions de ses compatriotes, et va ressasser, tout au long d’une œuvre romanesque aux accents bibliques, shakespeariens et joyciens, les angoisses de ce Sud hanté par un passé dont il ne peut se défaire et qui lui colle à l’âme.
Yoknapatawpha. Dans ce microcosme littéraire que Faulkner crée, reflet du « timbre-poste de [son] sol natal », nous évoluons loin des images rebattues d’un Sud de pacotille technicolor tel que dépeint dans Autant en emporte le vent. Dans le monde de Faulkner, les êtres ne se promènent pas avec nostalgie dans leurs rêves de gloire perdue, mais sont emportés, jusqu’à la souffrance, par la force inexorable et destructrice du passé. Les vivants sont déjà morts, les morts toujours vivants. Et leur souffrance est terrible car elle est méritée, Faulkner sait son pays corrompu par l’esclavagisme. Ce peuple d’êtres damnés, ce peuple d’ombres, enchaînés par une impitoyable fatalité les uns aux autres, peuple de blancs et de noirs, d’hommes et de femmes, de riches et de pauvres, erre dans sa propre déchéance, et ne fait que revivre et remâcher la débâcle de chaque destin, dans un enfer d’autant plus horrible qu’il n’a succédé à aucune époque heureuse mais a préexisté à tout. Il n’y a, en effet, pas de paradis perdu dans le monde faulknérien, il n’y a qu’un a priori sans Dieu, un monde abîmé par une précédente autre faute originelle, celle de l’effacement des indiens, qui n’ont dérisoirement gardé de leurs terres et leurs eaux que le nom mystérieux que nous peinons à prononcer : Yoknapatawpha.
Enfer, disais-je, enfer qui est l’infini retour de l’histoire, l’infini retour de la honte, infini retour du feu destructeur, des morts et de leurs exigences, de leurs armes, de leurs larmes. Le passé éternel est le seul présent de cette terre, et les hommes en sont tragiquement prisonniers. Nous ne sommes pas chez Proust ; ici le temps n’est ni perdu ni retrouvé, ici le temps n’est pas matière à mélancolie, il est la matière même de la pensée suppliciée. Tués sans fin, violés sans fin, emprisonnés sans fin ou poursuivis sans fin, les sombres héros faulknériens, impuissants, sont comme les titans condamnés, comme Prométhée et Atlas qu’on a soumis à un châtiment éternel. Les hommes endurent leur insupportable présence au monde, endurent la torture du temps passé toujours recommencé, toujours revécu dans les hurlements de douleur.
Cette épreuve atroce, épreuve ne signifiant rien, Faulkner entreprend de la traduire dans l’écriture même, créant ainsi une langue qui, sans discontinuer, veut saisir les perceptions paradoxales, les pensées tourmentées, les sentiments angoissants qui se chevauchent dans une confusion telle que les personnages, vivant dans l’étonnement et l’effroi perpétuel de leur châtiment, semblent se défaire et mourir des mots qu’ils prononcent. La langue faulknérienne, même traduite, possède un pouvoir envoûtant, véritable flot incantatoire qui se déroule sans fin, entraînant qui s’y abandonne dans un marécage où l’on se perd, s’étouffe, s’englue jusqu’à ce que cela tourne au long cauchemar. On n’avance pas dans Faulkner comme chez un autre romancier. On marche à l’aveugle, en suffocant. L’écriture faulknérienne revendique un hermétisme poétique, résiste aux explications claires, refuse à ce qui ne se dérobe pas. Il est illusoire de vouloir reconstruire la chronologie des existences, des récits, car l’histoire singulière de chaque homme se perd et se mêle à la grande histoire de l’humanité, jusqu’à un point limite où il n’y a plus que la chair et l’âme en souffrance, bientôt plus que les mots comme une lave en fusion, peut-être même plus de langue mais juste du bruit et de la fureur.
Ces personnages dont les noms se confondent – Bunch/Burch, Bundren/Burden, Reba/Ruby – vivent dans l’indétermination de leurs êtres. Ils ne sont que bouillonnement intérieur. Ils ne peuvent pas savoir ou comprendre ce qui leur arrive. La plupart sont dans ce lower Yoknapatawpha, des misérables jetés là, voués à l’humiliation, des misérables en marche sur une maudite route qui se perd dans un horizon de désespoir. Si nous reconnaissons parfois les silhouettes sorties des photos de Dorothea Lange ou de Walker Evans, eux ne parviennent pas à se reconnaître. Ils n’existent que comme étrangers à eux-mêmes, comme des paradoxes engendrés par les regards aveugles ou les mises à mort des autres. Ces personnages, violés ou violeurs, meurtriers ou meurtris, descendant d’esclaves ou de paysans blancs, sont les égales victimes du sang qui coule dans leurs veines, sang identique à celui qui a profondément imprégné la terre qu’ils parcourent.
Dans les lieux crépusculaires que Faulkner a créés, il faut accepter d’abandonner tout repère moral ou idéologique. Nul ne peut voyager dans ce comté s’il vient pour sermonner. Faulkner n’a pas écrit pour nous faire plaisir – les génies ne sont d’ailleurs pas là pour nous faire plaisir. Il faut sortir du politique, car les victimes ne sont plus celles que l’on croit. Dans le Yoknapatawpha, lieu de l’insupportable, la femme violée domine avec obscénité son violeur impuissant, le raciste est lui-même victime de son obsession délirante, la femme assassinée revient pour hanter son meurtrier et le pousser à mourir, la femme abandonnée revient pour forcer l’homme à reprendre la route. Maudits à différents égards, tous se perdent l’un l’autre, au point même que rien ne distingue désormais le blanc du noir, le bien du mal. L’homme n’est qu’un bœuf écorché. Le visage, le sexe et la couleur de peau ont disparu pour ne laisser place qu’à la chair déchirée, qu’aux entrailles à découvert. À notre époque où le passé est rejugé jusqu’à l’absurde à l’aune des évidences du présent, ce présent si sûr de ses vérités, l’ambition faulknérienne pourrait apparaître anachronique, dérangeante. N’est-il néanmoins pas toujours temps d’étudier, sans complaisance, la sombre clarté des bas-fonds de la conscience humaine ? Plus que maudit peut-être, Faulkner se révèle archaïque, un précieux archaïque, qui veut nous perdre dans les souterrains labyrinthiques et ténébreux de nos inavouables et irrationnels espaces intérieurs.
Après A little too much is not enough for U.S., créé en 2016 à l’occasion des Journées de juin, Lower Yoknapatawpha est le second volet que Xavier Gallais et moi-même consacrons aux États-Unis. Si la première pièce était une fresque consacrée au Maccarthysme et abordait notamment le monde de la politique à travers l’histoire des époux Rosenberg, ce nouvel opus américain a l’ambition d’entraîner les apprentis comédiens, comme les spectateurs, dans les terribles territoires hantés de nos crânes.
Florient AZOULAY
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
XAVIER GALLAIS
ADAPTATION ET DRAMATURGIE
FLORIENT AZOULAY
SCÈNOGRAPHIE – PROJET
LUCA ANTONUCCI
AVEC
MOHAMED BELHADJINE
ALINE BELIBI
MAËL BESNARD
TEDDY CHAWA
MANON CLAVEL
MÉGANE FERRAT
BENJAMIN GAZZERI GUILLET
LEAH LAPIOWER
JEAN-BAPTISTE LE VAILLANT
LOUISE LEGENDRE
ALEXANDRE MANBON
NADINE MORET
ANTHONY MOUDIR
D’après W. Faulkner le passé n’est jamais mort, il n’est même pas passé. On porte en soi une histoire qu’on ne peut pas nier et dont on ne parvient pas à se libérer.Ainsi, le sang des personnages faulknériens est inexorablement contaminé par les crimes irréparables et les défaites honteuses de leurs ancêtres. L’auteur les aban-donne sur une terre déjà maudite. Le comté imaginaire du Yobnapatawpha saccage l’illusion du mythe du Nouveau Monde : depuis longtemps, il n’y a plus de territoire vierge à découvrir. Plus de nature originelle et inviolée. Le paysage, même intérieur, a déjà été visité, souillé de partout, dans tous les sens. Tragiques, les personnages sont condamnés à endurer une réalité mouvante qui leur échappe bien souvent; condamnés à errer dans une temporalité disloquée à travers les labyrinthes de leur mémoire fragmentée. Il ne reste guère à ces êtres-là que les mots pour tenter de se réparer, peut-être retrouver la trace perdue d’une source pure? Mais la parole elle-même omet, remplace, dissimule car elle est poésie pure. Cauchemar absolu dont le rituel théâtral donne enfin à entendre les souffles affolés des spectres qui ont hanté l’imaginaire de bien des lecteurs exigeants.
XAVIER GALLAIS

L’ENFER DE L’HISTOIRE RECOMMENCÉE
Il est difficile pour nous de mesurer le traumatisme historique que représente aux États-Unis la guerre de Sécession, the Civil War. Ce conflit, qui a provoqué entre 1861 et 1865 la mort de près d’un million de personnes – sans compter les 500 000 mutilés et invalides –, demeure une des pages les plus tragiques de l’histoire américaine. Les 13 états confédérés, gouvernés par une petite aristocratie de gentlemen farmers qui régnaient sur plusieurs millions d’esclaves noirs, ont perdu près de 50% de leurs hommes, leurs hommes blancs, plongeant dans une longue période de ressentiment, où la rédemption morale était impossible, la reconstruction empêchée par l’arrogance des vainqueurs du Nord.
Les Sudistes vont dès lors ressasser jusqu’à l’obsession le temps heureux de l’avant-guerre et celui illustre des batailles, ancrant ainsi une large part de leur imaginaire dans une mythologie aussi outrancièrement idéalisée que sanglante. Dans les esprits des vaincus et de leurs descendants s’imposeront, à la place des ruines et des plantations dévastées, les visions idylliques de somptueuses demeures néo-palladiennes où de belles femmes en grande robe à crinoline, entourées d’élégants galants et de fidèles grosses nourrices noires, regardent depuis l’ombre douce des vérandas, nonchalamment alanguies sur des fauteuils en rotin, les esclaves travailler en chantant dans les champs de coton. Mais à ces tableaux kitsch, qui empestent le magnolia, des photos en noir et blanc vont bientôt succéder, images nauséabondes qui sentent la chair brûlée, la sinistre odeur des étranges fruits de Billie Holliday qui pendent aux arbres, l’odeur des lynchages, l’odeur de bois brûlé des grandes croix enflammées la nuit. Qui n’a à l’esprit, quand on évoque le sud des États-Unis, ces inquiétantes processions de fantômes armés, portant de longues robes blanches, et coiffés de capirotes qui masquent les visages ?
Si les monuments érigés à la gloire des héros confédérés dans les villes et les campus d’universités suscitent désormais de violentes polémiques, ils témoignent de la persévérance du mythe de la cause perdue, mythe rebelle. Les généraux en bronze, interrogeant l’histoire contemporaine de leur présence embarrassante, fiers et superbes sur leur cheval, regardent silencieusement un monde – car le sud des États-Unis fait monde – où règne toujours l’injustice raciale, triste héritage de l’esclavage et de la ségrégation. À Charlottesville, il y a un peu plus d’un an, lors d’un rassemblement d’extrême-droite visant à empêcher le déboulonnage de la statue du général Robert E. Lee, un jeune suprémaciste blanc a foncé en voiture sur des contre-manifestants antiracistes, tuant une personne et en blessant une vingtaine. Un siècle et demi après, la rancœur demeure. Les États-Unis n’ont cessé de faire croire à l’union, mais aujourd’hui encore – et Donald Trump en est l’ubuesque symbole –, ce pays reste profondément divisé. Les frontières existent bel et bien, dans les terres, dans les consciences.
Plus que dans la folie – ou plutôt la bêtise – meurtrière de quelques extrémistes isolés, c’est dans sa littérature que le sud des États-Unis mérite qu’on s’intéresse à l’expression troublante et brutale de son ressentiment. Une longue série d’écrivains de premier ordre, Flannery O’Connor, Eudora Welty, Carson McCullers, Margaret Mitchell – beaucoup de femmes nourriront de leur récits l’imaginaire sudiste –, Erskine Caldwell ou Robert Penn Warren, va entreprendre de raconter les affres des habitants de ce territoire maudit. Le plus puissant de tous reste, sans conteste, William Faulkner, prix Nobel de littérature en 1949, qui laisse à la littérature des chefs-d’œuvre de noirceur tels que Le Bruit et la fureur, Tandis que j’agonise, Lumière d’août ou Absalon, Absalon !
Vivant dans la petite ville d’Oxford dans le Mississippi, Faulkner, dont le grand-père a servi comme colonel dans l’armée confédérée, partage les obsessions de ses compatriotes, et va ressasser, tout au long d’une œuvre romanesque aux accents bibliques, shakespeariens et joyciens, les angoisses de ce Sud hanté par un passé dont il ne peut se défaire et qui lui colle à l’âme.
Yoknapatawpha. Dans ce microcosme littéraire que Faulkner crée, reflet du « timbre-poste de [son] sol natal », nous évoluons loin des images rebattues d’un Sud de pacotille technicolor tel que dépeint dans Autant en emporte le vent. Dans le monde de Faulkner, les êtres ne se promènent pas avec nostalgie dans leurs rêves de gloire perdue, mais sont emportés, jusqu’à la souffrance, par la force inexorable et destructrice du passé. Les vivants sont déjà morts, les morts toujours vivants. Et leur souffrance est terrible car elle est méritée, Faulkner sait son pays corrompu par l’esclavagisme. Ce peuple d’êtres damnés, ce peuple d’ombres, enchaînés par une impitoyable fatalité les uns aux autres, peuple de blancs et de noirs, d’hommes et de femmes, de riches et de pauvres, erre dans sa propre déchéance, et ne fait que revivre et remâcher la débâcle de chaque destin, dans un enfer d’autant plus horrible qu’il n’a succédé à aucune époque heureuse mais a préexisté à tout. Il n’y a, en effet, pas de paradis perdu dans le monde faulknérien, il n’y a qu’un a priori sans Dieu, un monde abîmé par une précédente autre faute originelle, celle de l’effacement des indiens, qui n’ont dérisoirement gardé de leurs terres et leurs eaux que le nom mystérieux que nous peinons à prononcer : Yoknapatawpha.
Enfer, disais-je, enfer qui est l’infini retour de l’histoire, l’infini retour de la honte, infini retour du feu destructeur, des morts et de leurs exigences, de leurs armes, de leurs larmes. Le passé éternel est le seul présent de cette terre, et les hommes en sont tragiquement prisonniers. Nous ne sommes pas chez Proust ; ici le temps n’est ni perdu ni retrouvé, ici le temps n’est pas matière à mélancolie, il est la matière même de la pensée suppliciée. Tués sans fin, violés sans fin, emprisonnés sans fin ou poursuivis sans fin, les sombres héros faulknériens, impuissants, sont comme les titans condamnés, comme Prométhée et Atlas qu’on a soumis à un châtiment éternel. Les hommes endurent leur insupportable présence au monde, endurent la torture du temps passé toujours recommencé, toujours revécu dans les hurlements de douleur.
Cette épreuve atroce, épreuve ne signifiant rien, Faulkner entreprend de la traduire dans l’écriture même, créant ainsi une langue qui, sans discontinuer, veut saisir les perceptions paradoxales, les pensées tourmentées, les sentiments angoissants qui se chevauchent dans une confusion telle que les personnages, vivant dans l’étonnement et l’effroi perpétuel de leur châtiment, semblent se défaire et mourir des mots qu’ils prononcent. La langue faulknérienne, même traduite, possède un pouvoir envoûtant, véritable flot incantatoire qui se déroule sans fin, entraînant qui s’y abandonne dans un marécage où l’on se perd, s’étouffe, s’englue jusqu’à ce que cela tourne au long cauchemar. On n’avance pas dans Faulkner comme chez un autre romancier. On marche à l’aveugle, en suffocant. L’écriture faulknérienne revendique un hermétisme poétique, résiste aux explications claires, refuse à ce qui ne se dérobe pas. Il est illusoire de vouloir reconstruire la chronologie des existences, des récits, car l’histoire singulière de chaque homme se perd et se mêle à la grande histoire de l’humanité, jusqu’à un point limite où il n’y a plus que la chair et l’âme en souffrance, bientôt plus que les mots comme une lave en fusion, peut-être même plus de langue mais juste du bruit et de la fureur.
Ces personnages dont les noms se confondent – Bunch/Burch, Bundren/Burden, Reba/Ruby – vivent dans l’indétermination de leurs êtres. Ils ne sont que bouillonnement intérieur. Ils ne peuvent pas savoir ou comprendre ce qui leur arrive. La plupart sont dans ce lower Yoknapatawpha, des misérables jetés là, voués à l’humiliation, des misérables en marche sur une maudite route qui se perd dans un horizon de désespoir. Si nous reconnaissons parfois les silhouettes sorties des photos de Dorothea Lange ou de Walker Evans, eux ne parviennent pas à se reconnaître. Ils n’existent que comme étrangers à eux-mêmes, comme des paradoxes engendrés par les regards aveugles ou les mises à mort des autres. Ces personnages, violés ou violeurs, meurtriers ou meurtris, descendant d’esclaves ou de paysans blancs, sont les égales victimes du sang qui coule dans leurs veines, sang identique à celui qui a profondément imprégné la terre qu’ils parcourent.
Dans les lieux crépusculaires que Faulkner a créés, il faut accepter d’abandonner tout repère moral ou idéologique. Nul ne peut voyager dans ce comté s’il vient pour sermonner. Faulkner n’a pas écrit pour nous faire plaisir – les génies ne sont d’ailleurs pas là pour nous faire plaisir. Il faut sortir du politique, car les victimes ne sont plus celles que l’on croit. Dans le Yoknapatawpha, lieu de l’insupportable, la femme violée domine avec obscénité son violeur impuissant, le raciste est lui-même victime de son obsession délirante, la femme assassinée revient pour hanter son meurtrier et le pousser à mourir, la femme abandonnée revient pour forcer l’homme à reprendre la route. Maudits à différents égards, tous se perdent l’un l’autre, au point même que rien ne distingue désormais le blanc du noir, le bien du mal. L’homme n’est qu’un bœuf écorché. Le visage, le sexe et la couleur de peau ont disparu pour ne laisser place qu’à la chair déchirée, qu’aux entrailles à découvert. À notre époque où le passé est rejugé jusqu’à l’absurde à l’aune des évidences du présent, ce présent si sûr de ses vérités, l’ambition faulknérienne pourrait apparaître anachronique, dérangeante. N’est-il néanmoins pas toujours temps d’étudier, sans complaisance, la sombre clarté des bas-fonds de la conscience humaine ? Plus que maudit peut-être, Faulkner se révèle archaïque, un précieux archaïque, qui veut nous perdre dans les souterrains labyrinthiques et ténébreux de nos inavouables et irrationnels espaces intérieurs.
Après A little too much is not enough for U.S., créé en 2016 à l’occasion des Journées de juin, Lower Yoknapatawpha est le second volet que Xavier Gallais et moi-même consacrons aux États-Unis. Si la première pièce était une fresque consacrée au Maccarthysme et abordait notamment le monde de la politique à travers l’histoire des époux Rosenberg, ce nouvel opus américain a l’ambition d’entraîner les apprentis comédiens, comme les spectateurs, dans les terribles territoires hantés de nos crânes.
Florient AZOULAY